Préserver la biodiversité et les services qu'elle nous rend demande une évolution des pratiques liées à certaines activités humaines. La séquence "éviter – réduire – compenser "(ERC) porte en particulier sur la planification et les projets d'aménagement du territoire. Un ensemble d'outils permet de comprendre la réglementation associée à ces projets, et de l'appliquer via des référentiels techniques et ouvrages méthodologiques.
Préserver les espèces de faune et de flore, les milieux naturels, de même que les fonctions et les services associés à ces écosystèmes, nécessite d’adapter voire de modifier certaines pratiques en matière d’aménagement du territoire, de conception et de budgétisation des projets, de réalisation des chantiers, et de mise en œuvre de certaines activités humaines.
À cette fin, la séquence "éviter – réduire – compenser "(ERC) constitue le fil conducteur d'intégration de l'environnement au sein :
- des documents de planification (SRADDET, PLU, Sdage, Sage, PGRI, etc.)
- des projets tels que les infrastructures de transport, les ZAC, les zones industrielles, les carrières, les travaux d'entretien de milieux naturels, les parcs photovoltaïques ou éoliens, les activités de loisir, etc. L'ensemble de ces projets est susceptible d’altérer, de dégrader voire de détruire des milieux naturels, des espèces végétales et animales, des fonctions, des services écosystémiques, etc.
Utiliser ERC pour réduire l'impact des projets d’aménagement du territoire
Dans le cas des projets d’aménagement du territoire, la séquence ERC se traduit techniquement par un séquençage des choix techniques à effectuer par les maîtres d’ouvrage pour leurs projets, et ce, au regard des enjeux environnementaux. Ce séquençage comprend 3 étapes successives.
- Chercher toutes les alternatives permettant d’éviter les atteintes à la biodiversité et aux services écosystémiques que le projet pourrait engendrer.
- À défaut, proposer des mesures permettant de réduire, au droit du projet, les atteintes qui n’ont pu être suffisamment évitées.
- En dernier lieu, compenser les atteintes notables à l’environnement qui n’ont pu être ni évitées ni suffisamment réduites, en réalisant des actions favorables à l’environnement.
Cette contrepartie est apportée aux impacts notables et négatifs du projet sur les milieux naturels. Elle doit cibler les mêmes composantes (en termes d’espèces, d’habitats et de fonctions) que celles altérées, dégradées voire détruites par le projet.
Ces 3 étapes s’appliquent tout au long de la "vie" du projet, des phases amont de conception et de budgétisation, aux phases d’instruction, de chantier puis de mise en service (ou d'exploitation).
Elles nécessitent au préalable de réaliser un état initial des milieux naturels directement et indirectement concernés par le projet, comprenant notamment une évaluation :
- de leurs fonctions physiques, bio-géochimiques et biologiques,
- de leurs services de régulation, d'approvisionnement et culturels, l'ensemble constituant des facteurs de bien-être pour la société (sécurité, santé, cadre de vie, apport de nourriture, relations sociales, etc.),
- et de leurs enjeux (statut de protection, typicité, degré de menace, etc.).
Comprendre la séquence ERC, de la réglementation à l'application concrète
Un ensemble de ressources organisées sont mises à disposition via 2 outils principaux.

Accueil du centre de ressources ERC-Biodiversité
Le centre de ressources ERC Biodiversité
Piloté par l’Office français de la biodiversité (OFB), le centre national de ressources ERC-Biodiv donne accès à des informations et des outils visant à mieux comprendre et appliquer la séquence « éviter, réduire, compenser (ERC) » sur le volet biodiversité (espèces, milieux naturels, fonctions et services associés). Ces éléments sont relatives aux documents de planification et aux projets d’aménagement du territoire soumis à évaluation environnementale.
Ce sont des documentations, réglementations, jurisprudences, méthodes, outils et retours d’expériences favorisant une application vertueuse de la séquence ERC et des mesures de suivi et d’accompagnement qui la complètent.
À vocation pédagogique, ce site a pour finalité d’accompagner techniquement les acteurs pour la mise en œuvre des politiques publiques et dans leur montée en compétences. Il s'adresse prioritairement des acteurs professionnels d’ERC :
- internes : agents de l’OFB en charge de l’appui technique et du contrôle des mesures ERC,
- et externes : services instructeurs de l’État, maîtres d’ouvrage, bureaux d’étude, collectivités...
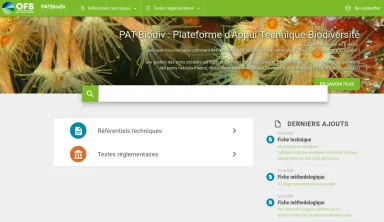
Accueil de PatBiodiv
Patbiodiv, la plateforme d’appui technique Biodiversité
L’application web Pat Biodiv s'adresse à de multiples utilisateurs :
- internes (OFB) ou rattachés à l’OFB (Parcs nationaux),
- externes :
- partenaires : services déconcentrés de l’État, MNHN, Inrae, Cerema...,
- maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre, bureaux d’étude, collectivités...
Elle est composée de deux volets :
- une base documentaire technique et réglementaire ouverte à tous, déclinant la séquence ERC par type d’opérations,
- une partie réservée aux agents de l’OFB et des parcs nationaux, permettant la gestion des actes produits par ces établissements : avis techniques, délibérations des parcs naturels marins, décisions des parcs nationaux.
Particularités de la mise en œuvre d’ERC pour des sujets spécifiques
Définition des mesures ERC
- Évaluation environnementale - Guide d’aide à la définition des mesures ERC, Commissariat général au développement durable, Cerema, Théma - Balises, 134 p. Janvier 2018 : ce guide propose une aide à la définition des mesures ERC à destination des services instructeurs, maîtres d’ouvrages et autres acteurs de la séquence ERC dans le but d’optimiser sa mise en œuvre.
- Définition des mesures « éviter, réduire, compenser » relatives au milieu marin, Commissariat général au développement durable, 80 p. Février 2023 : ce guide est une nécessaire déclinaison pour le milieu marin et le littoral de la séquence ERC : il concerne les projets localisés en mer et sur la partie marine du littoral, et les documents de planification (plans et programmes) soumis à évaluation environnementale en lien avec la mer et/ou le littoral de toutes échelles.
Compensation écologique
Lorsque des atteintes à la biodiversité sont prévues dans le cadre d’un projet ou d’un aménagement à venir, des mesures de compensation doivent être apportées pour contrebalancer ces atteintes et rechercher une absence de perte nette de biodiversité.
Ces mesures de compensation doivent apporter des améliorations sur des composantes équivalentes à celles qui vont être altérées, et à proximité fonctionnelle (pour « remplacer » les fonctionnalités altérées).
Ces mesures de compensation font partie intégrante du projet et sont sous la responsabilité des maîtres d’ouvrage, qui doivent les prévoir dans leur dossier de demande d’autorisation. Elles sont inscrites en tant que prescriptions dans l’acte d’autorisation d’un projet, ce qui en permet le contrôle.
Deux modalités possibles pour réaliser la compensation :
- directement par le maître d’ouvrage ou son prestataire : compensation à la demande,
- par acquisition d’unités de compensation générées par des opérateurs de compensation sur des sites naturels de compensation : compensation par l’offre.
-
Dommage écologique et réparation ou compensation écologique
La prise en compte des dommages écologiques reste difficile et la réparation des préjudices qui en découlent peu nombreuses ou mal proportionnées. Pour le juge qui ordonne la réparation de ces atteintes, la priorité est donc de caractériser et évaluer les dommages écologiques qui découlent des infractions constatées par les inspecteurs de l’environnement. Cette page rassemble les ressources et travaux produits sur le sujet.
Dimensionnement de la compensation
Film présentant l’approche standardisée du dimensionnement de la compensation (OFB, Cerema)
Durée : 3 min 30 sec
Vidéo YouTube [8 étapes clés pour compenser les impacts d’un projet d’aménagement sur la biodiversité]Huit étapes clés pour compenser les impacts d'un projet d'aménagement sur la
biodiversité dans le cadre de la séquence Eviter Réduire Compenser
La compensation écologique vise à générer des gains de biodiversité au moins aussi important que les pertes qui n'ont pas pu être évitées ou réduites. Elle vise deux objectifs :
- l'absence de perte nette de biodiversité qui implique qu'aucun impact remettant en cause l'état de conservation de la biodiversité ne doit persister
- l'équivalence écologique qui implique que les mesures de compensation doivent cibler les mêmes habitats, espèces et fonctions écologiques que ceux affectés par le projet.
Etape 1 : les impacts sur la biodiversité sont-ils compensables ? Si les impacts touchent des éléments de biodiversité qui ne peuvent pas être remplacés ou que l'ampleur des impacts est trop importante, la compensation ne pourrait pas prévenir l'absence de perte nette de biodiversité.
Etape 2 : les impacts résiduels sont-ils significatifs ? S'ils perturbent, altèrent ou détruisent des espèces ou des habitats au point de remettre en question leur état de conservation ou des fonctions écologiques essentielles, les impacts sont significatifs et doivent alors être compensés, sinon il n'est pas nécessaire de compenser.
Etape 3 : les mesures de compensation sont-elles possibles ? S'il existe un ou des sites de compensation adaptés à proximité du projet et que les mesures de compensation envisagée sont réalisables techniquement, les mesures de compensation sont possibles. Sinon le projet doit être repensé.
Etape 4 : la méthode de compensation permet d'évaluer l'atteinte de l'équivalence écologique. La méthode de compensation doit être cohérente avec la réglementation, avec l'état actuel des connaissances écologiques. Elle doit être transparente, explicitée et justifiée sinon elle doit être complétée ou changée.
Etape 5 : les informations choisies pour évaluer les pertes et les gains sont-elles exhaustives ? Le tableau des informations requises pour le processus de dimensionnement recoupe les trois composantes de biodiversité à
prendre en compte les espèces - les habitats - les fonctions et permet de vérifier que les pertes et les gains sont exprimés de manière comparable et exhaustive.
Etape 6 : Les mesures de compensation sont-elles conformes aux conditions législatives ? Les mesures de compensation doivent être efficaces, être effectives dès les premiers impacts et tant que dureront les impacts,sinon il faut modifier les modalités de compensation ou repenser le projet.
Etape 7 : l'équivalence écologique peut-elle être atteinte ? L'équivalence écologique peut être atteinte lorsque toutes les espèces, habitat et fonctions écologiques subissant des impacts résiduels significatifs font l'objet de mesures de compensation dans les mêmes proportions et en maintenant la même qualité fonctionnelle.
Etape 8 : l'état écologique du site compensé est-il bien conforme aux résultats attendus ? L'efficacité de chaque mesure de compensation est suivie dans le temps. Si le résultat n'est pas conforme aux objectifs, il faut mettre en place des mesures correctives. Si le résultat est conforme alors les mesures de compensation sont correctement dimensionnées et l'équivalence écologique est atteinte.
Compensation écologique des cours d’eau. Exemples de méthodes de dimensionnement (CGDD, Cerema, AFB)
Cet ouvrage technique présente des méthodes de dimensionnement de la compensation écologique spécifiques aux cours d’eau, utilisées aux États-Unis. Elles permettent de comparer pertes écologiques engendrées par un projet et gains écologiques liés à la mise en œuvre de mesures de compensation. Les méthodes sont analysées, puis les possibilités de transposition au contexte français étudiées.
Modèles de rédaction des prescriptions spécifiques aux mesures de compensation
Modèles de rédaction des prescriptions spécifiques aux mesures de compensation
Cet ouvrage s’adresse plus particulièrement aux services instructeurs en charge de rédiger les actes administratifs d’autorisation des projets soumis à la loi sur l’eau. Il rappelle les points de vigilance pour assurer la sécurité juridique des actes administratifs et propose 2 modèles de rédaction.
Compensation par l’offre
Des opérateurs de compensation génèrent des unités de compensation par leur actions de restauration de la biodiversité sur des sites naturels de compensation. Cette modalité permet de mettre en œuvre la compensation de manière anticipée et mutualisée, et ainsi d’améliorer son efficacité.
Un agrément ministériel atteste la nature et la quantité d’unités écologiques disponibles sur ces sites.
À partir de l’analyse des expérimentations de sites de compensation menées entre 2008 et 2020, l’Inrae a élaboré des critères d’analyse pour évaluer la pertinence des sites de compensation. La grille d’évaluation de la pertinence écologique (Gepe) permet :
- aux porteurs de projets de compensation par l’offre d'évaluer la pertinence écologique de leur projet à toutes les étapes de son élaboration,
- et aux services instructeurs de l'État d'évaluer un projet sollicitant un agrément à ce titre.
Cette grille est composée de 34 critères pour 2 volets :
- s’assurer de la complétude du dossier : état initial, objectifs, composantes de biodiversité ciblées…,
- analyser le fond et en particulier la nature, l’ampleur et la probabilité d’obtenir le gain écologique visé.
Le Guide pour l’élaboration d’un site naturel de compensation (CGDD, 2023) accompagne le déploiement de ces sites et s'adresse aux opérateurs de compensation et services instructeurs. Il explique le dispositif, propose des éléments méthodologiques et aide à la constitution du dossier de demande d’agrément ministériel.
Suivi des mesures de compensation dans le temps
L'outil GéoMCE est à disposition des services instructeurs pour enregistrer les mesures de compensation liées à un projet ainsi que les prescriptions afférentes. Une extraction de cet outil est visualisable par le grand public sur le Geoportail de l’IGN.
Inventaire des sites à fort potentiel de gain écologique : l'application Pogéis
Les maîtres d’ouvrage de projets rencontrent une difficulté majeure : la recherche de sites disponibles pour réaliser des mesures de compensation. Aussi la loi de reconquête de la biodiversité de 2016 a-t’elle confié à l’OFB la réalisation d’un inventaire de sites à fort potentiel de gain écologique. En effet, l’existence d’un potentiel de gain écologique, ou plus simplement dit d’une marge de progrès, est la condition première pour qu’un site puisse recevoir une mesure de compensation.
L’OFB, avec l’appui de groupes de travail regroupant l’ensemble des acteurs concernés par le sujet, a élaboré l'application "Pogéis" : elle permet de réaliser un inventaire de sites de manière collaborative. Ils pourront faire l’objet de projets de restauration écologique, élaborés dans le cadre réglementaire de la compensation écologique ou dans tout autre cadre (engagement volontaire de restauration des écosystèmes, contrat Natura 2000, etc.).
-
Pogéis, l'inventaire des sites à fort potentiel de gain écologique
Pogéis est une plateforme gratuite et collaborative qui recense le foncier disponible pour la restauration écologique. Elle facilite le lien entre les acteurs et permet de prioriser les terrains les plus pertinents pour restaurer la biodiversité.

